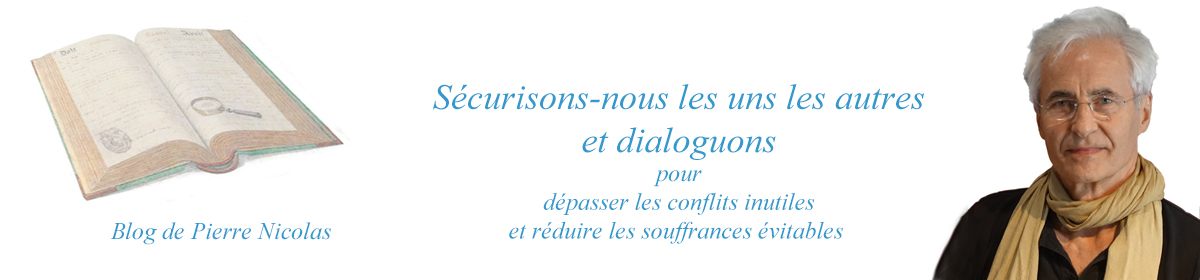Barbie (suite et fin) : démontons les enjeux
07/23/2023
Hier, j’ai dit l’intérêt que j’ai pris à cette rétrospective humoristique sur l’un des mythes qui ont hanté ma génération, celle des baby-boomers, et les plaisirs donnés par ce mélodrame pour adultes. Le pacte narratif L’article ci-après opère à contresens. Au lieu de se laisser emporter par un…
Barbie (le film), avant – après
07/22/2023
Avant Mon épouse voulait voir « Barbie ».J’ai accepté : cela me changerait des idées de grande politique, sombres et critiques, sur lesquelles je tourne en permanence. Pour me débarrasser plus vite de cette « petite connerie », nous irons ce matin à la première séance. Depuis, j’ai…
Ignorants de notre propre nature
07/20/2023
Le New York Times vient de mettre en ligne l’article suivant. Il est nourri, intelligent, documenté à lire attentivement par toute personne intéressée par les processus de production des énoncés collectifs (ce que les naïfs et partisans appellent des « vérités »). Wikipedia’s Moment of Truth https://vp.nyt.com/video/2023/07/13/110013_1_23mag-wikipedia-1_wg_1080p.mp4 Pour…
Vilnius 2023 NATO Summit & France’s 14th of July
07/17/2023
Macron's France has placed itself under the aegis of the United States in order to preserve its national niche as the third largest arms dealer (11% of the world market) behind the USA (40%) and Russia (16%). This subjugation may seem validated by the contract signed with Narendra…